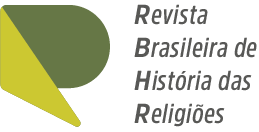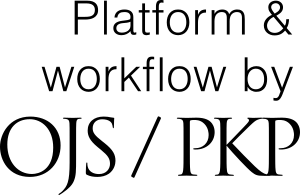Les religions dans les Etats traditionnelles d’Afrique noire entre le XIX et le XXe siècles: cas de l’Islam et du Christianisme dans le Royaume Bamum (Ouest-Cameroun)
DOI :
https://doi.org/10.18764/1983-2850v18n52e26031Mots-clés :
Royaume Bamum, religions traditionnelles, Islam, Christianisme, Nouveaux Mouvement religieuxRésumé
Entre le XIXe et le XXe siècles, le Royaume Bamum a été le théâtre de bouleversements politiques et socio-culturels. Les religions importées à l’instar de l’Islam et du Christianisme firent leur arrivée dans cette monarchie des Grassfields où les religions traditionnelles sont pratiquées depuis plusieurs siècles. Cet article a pour objectif de présenter et d’analyser l’implantation et l’évolution des religions importées dans ce royaume traditionnel. Ainsi, depuis quand et comment l’islam et christianisme sont-ils devenus des religions de masse dans le Royaume Bamum alors que les populations y pratiquaient déjà des religions traditionnelles ? Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes appuyés sur les sources orales, écrites, iconographiques, numériques. Par une approche qui se veut à la fois diachronique, synchronique et comparatiste, nous avons pu constater que l’histoire des religions importées en pays bamum remonte au XIXe siècle. C’est à la suite de l’intervention de la cavalerie peule du Lamido Oumarou de Banyo dans la guerre civile en pays bamum en 1896 que le Roi Njoya décida d’adopter l’Islam. L’implantation du Christianisme quant à lui est liée à l’intrusion européenne. Les missionnaires protestants et catholiques se sont installés à Foumban vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècles. Mais, avec la libéralisation des années 90, on a remarqué l’avènement de Nouveaux Mouvements Religieux (NMR). Quoiqu’il en soit, l’on distinguait dans le Royaume Bamum en matière d’islam d’une part les courants plus récents à savoir le Sunnisme (et surtout le Wahhabisme) et le Chiisme qui se développent à côté d’un courant plus ancien dénommé la confrérie Tijâniyya (branche du Soufisme). Dans le christianisme, d’autre part, on enregistre la montée fulgurante des « Eglises de Réveil » et ce, au grand dam des religions traditionnelles.
Téléchargements
Metrics
Références
Les sources orales
CHEICK MAMA Awal, entretien, Imam et spécialiste en théologie et droit islamique, 48 ans environ, Foumban le 05/08/2021.
NCHARE Oumarou, entretien, Directeur de l’administration générale au palais des Rois Bamum, Foumban le 04/08/2021.
NJOYA Jean, entretien, Catéchiste catholique, environ 65 ans, Foumban le 05/08/2021.
Les sources écrites
BOUCHAUD, R. P. L’Eglise en Afrique noire (mission d’hier et missions d’aujourd’hui), Genève/Paris, Ed La Palae, 1958.
DERRIDA, Jacques. Foi et Savoir, suivi de Le Siècle et le Pardon, Ed : Seuil, 2000.
DIA, Mouhamadou. Islam, Sociétés Africaines et culture industrielle, Dakar-Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, 1975.
DIOP, Cheikh Anta. Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ?, Paris, Présence africaine, 1967.
FUGIER, H., (1963), Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, Paris, Les Belles Lettres, 1963.
HADJADJ, F. « La personne, la transcendance et l’État. La laïcité n’est pas l’anti-religion ». Revue du MAUSS, 1(1), 2017, p. 319-326.
HOURS, B. « La faillite du politique et la laïcité : De l’émancipation sociale ratée à la soumission religieuse ». Journal des anthropologues, 3(3-4), 2016, p. 57-65.
JEUGE- MAYNART, (Dir). Le petit dictionnaire Larousse illustré, Paris, Larousse, 2012.
KANE, O., Othman Dan Fodio (Fondateur de l’empire de Sokoto), Paris, ABC/ Dakar-Abidjan, NEA, 1976.
MATATEYOU, Emmanuel. Les sociétés sécrètes dans la littérature camerounaise : le cas des Bamoun. Thèse de Doctorat en Littérature francophone, Université de Lille, 1988.
MAUD, L. « Les religions ». In : YAHMED BEN D. et HOUSTIN N. (Dir), Altlas du Cameroun, Paris, Editions Jeune Afrique aux Editions du Jaguar-Sifija, 2010, p. 96-97.
MBOHOU, Sylvain. Le Royaume Bamum (Ouest) et le Lamidat de Banyo (Adamaoua) dans les traites négrières arabo-musulmane et transatlantique
(1823 à 1923). Thèse de Doctorat/ Ph.D en Histoire, Université de Dschang-Cameroun, 2021.
MOHAMMADOU, Eldridge. Climat et Histoire en Afrique centrale au XVIII et XIXe siècle : L’expansion Baaré-Chamba de la Haute Bénoué (Cameroun), vol 1, Shimada & Mahmoudou Djingui, Nagoya University, 2004.
MOHAMMADOU, Eldridge. Les Royaumes Foulbés de L’Adamaoua au XIX siècle, Tokyo, ILCAA, 1978.
NGONGO, Louis. Histoire des forces religieuses au Cameroun : de la Première guerre mondiale à l’indépendance (1916-1955), Paris, Karthala, 1982.
NJEUMA, Martin Zakari. Fulany hegemony in Yola (Old Adamawa): 1809-1902, Yaoundé, CEPER, 1978.
NJIASSE-NJOYA, Aboubakar et Als . De Njoya à Njimoluh : cent ans d’histoire Bamum, Foumban, Editions du Palais, 1984.
NJIASSE-NJOYA, Aboubakar. Naissance et évolution de l’islam dans le Royaume Bamoun. Thèse de Doctorat du 3e cycle en Histoire, Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1980.
NJIKAM, Théophile. Pressions françaises et résistance du sultanat bamoun : 1919-1945. Mémoire de DIPES II en Histoire, ENS de Yaoundé, 1986.
NJOYA. Histoire et Coutumes Bamoun, traduction du Pasteur Henri Martin, Mémoire de l’IFAN, n°5, 1952.
ONOMO ETABA, Roger Bernard, FOUELLEFACK KANA, Colette, DONLEFACK, Martin. (2014). In : « Diplomatie traditionnelle et rapprochement des cultures : rôle du roi Njoya dans l’épanouissement de la culture musulmane en pays bamiléké », https://www.academia.edu/31493606/ ; (consulté le 13/10/2020).
SA’AD, Aboubakar. The Lamibe of Fombina, Zaria, Zaria University Press, 1977.
SAHA, Zacharie et KOUOSSO, Jean Romain, (SDD). Les Grassfields du Cameroun (des fondements culturels au développement humain), Yaoundé, CERDOTOLA, 2017.
SEHOU, Ahmadou. L’esclavage dans les Lamidats de l’Adamaoua (Nord-Cameroun), du début du XIXe à la fin du XXe siècles. Thèse de Doctorat/Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, Tome I et II, 2016.
TARDITS, Claude. « Passage d’une religion traditionnelle africaine (culte des ancêtres) à l’islam : le cas bamoun ». In Sociétés africaines, monde arabe et culture islamique. Mémoires du CERMAA, no. 1. Paris, Centre d’études sur les relations entre le monde arabe et l’Afrique, 1981.
TROUMBA, Claude. « Nouveaux Mouvements Religieux et pouvoir politique : contribution à l’étude de la politisation des Eglises pentecôtistes de Yaoundé », Mémoire de Master en Sociologie, Université de Yaoundé I, 2018.
TRIAUD, Jean-Louis et Robinson, David. (éds). La Tijâniyya. Une confrérie à la conquête de l’Afrique. Paris: Karthala, 2000.
VAN SLAGEREN, Jaap, Les Origines de l’Eglise évangélique du Cameroun. Missions européennes et christianisme autochtone. Yaoundé: CLE; Leiden: Brill,1972.
Les sources numériques
Anonyme, « Djihad ou Jihad » Disponible dans : https://www.universalis.fr/encyclopedie/djihad-jihad, (consulté le 27/07/ 2018).
Anonyme, « Jihad in Islam: A concept misconstrued». Disponible dans : https://www.cameroonweb.com /CameroonHomePage/features/Jihad-in-Islam-A-concept-misconstruedn, (consulté le 27/07/ 2018).
MOUICHE, Ibrahim. « Islam, mondialisation et crise identitaire dans le Royaume Bamoun », Journal of International African Institute, Vol 75, N°3, 2005, p. 378-420. Disponible dans : https://www.jstor.org/stable/3556753, (consulté le 24/03/2009).
NGO NLEND, Nadège. « Le christianisme dans les enjeux de pouvoir en pays bamoun, Ouest du Cameroun, hier et aujourd’hui », Études théologiques et religieuses, 88, 2013, p. 73-87. Disponible dans https://doi.org/10.3917/etr.0881.0073, (consulté le 13/10/2021).
POISSONIER, Ariane, « Prière Chiite à Douala ». Disponible dans : http://www1.rfi.fr/actufr/articles/041/article_21999.asp , (consulté le 13/10/2021).
SHEIKH MUHAMMAD, Abû Zahrah, « La conception de la guerre en islam Dâr al-harb et Dâr al-islâm” (Traduction de Ceza Ahmed Kassem). Disponible dans : https://www.islamophile.org/spip/Dar-al-harb-et-dar-al-islam, (consulté le 27/07/2018).
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés Revista Brasileira de História das Religiões 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.